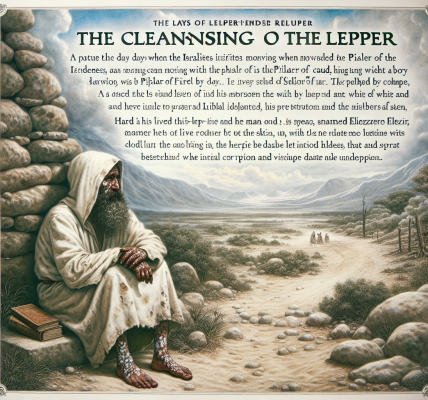Le pays n’avait pas de roi en ces jours-là. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette phrase, lourde comme une pierre tombale, reviendrait plus tard pour sceller le récit. Mais pour l’heure, tout commençait par un homme, un Lévite, installé dans les contreforts lointains de la tribu d’Éphraïm.
Il avait pris pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Le mot « concubine » sonnait déjà comme un statut ambigu, une possession à moitié reconnue. Elle, justement, s’était querellée avec lui. Une dispute dont on ne sut jamais le cœur, peut-être une brûlure d’orgueil, ou une lassitude face à son maître. Elle était partie, revenue dans la maison de son père, à Bethléem. Et elle y était restée, quatre mois pleins.
Le Lévite, au bout de ce temps, s’était décidé à la reprendre. Non pas dans un élan de passion, mais pour « parler à son cœur », disent les anciens rouleaux. Parler à son cœur… l’expression avait la douceur d’une tentative. Il se mit en route avec son serviteur et deux ânes. Le père de la jeune femme le vit arriver et, le cœur joyeux — était-ce de le revoir ou de revoir le prestige d’un Lévite ? —, il le retint. La bienvenue dura trois jours. On mangea, on but, on dormit. Une douceur étrange, suspendue, comme si le temps pouvait effacer la rupture.
Le quatrième jour, le Lévite se leva tôt, résolu à repartir. Mais le beau-père insista : « Fortifie ton cœur avec un morceau de pain. » On resta. On mangea encore. Le cinquième jour, même scène. L’aube pointait, l’homme se préparait. « Je t’en prie, fortifie ton cœur, attends au déclin du jour. » Et l’on traîna encore à table, jusqu’à ce que l’après-midi baisse. Alors, enfin, le Lévite partit, avec sa concubine et son serviteur. L’hésitation du départ semblait déjà un mauvais présage.
Ils quittèrent Bethléem tard. Le soleil oblique allongeait des ombres violettes sur le chemin de pierres. Jérusalem, alors aux mains des Jébuséens, était proche, mais le serviteur suggéra de pousser plus loin, vers une ville israélite. « Non, dit le Lévite. Nous n’entrerons pas chez des étrangers. » Ils passèrent donc leur chemin, gravissant la route montante vers Guibea, en Benjamin.
Le crépuscule tomba quand ils y parvinrent. Ils s’assirent sur la place, à l’entrée de la ville, mais personne ne les invita à passer la nuit. La coutume de l’hospitalité, sacrée, était morte ici. Ils attendirent, la poussière du voyage collée à la peau, dans le silence grandissant. Finalement, un vieil homme rentra des champs, tardivement. Lui aussi était originaire de la montagne d’Éphraïm ; il vivait désormais comme étranger à Guibea. Son regard croisa celui du voyageur délaissé. « Où vas-tu, et d’où viens-tu ? » demanda-t-il. La réponse du Lévite fut simple : « Nous passons de Bethléem de Juda aux confins d’Éphraïm. Personne ne nous ouvre sa maison. Pourtant, nous avons de la paille et du fourrage pour nos ânes, du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui suit tes serviteurs. Nous ne manquons de rien. »
Le vieil homme eut un geste las. « Que la paix soit avec toi. Je pourvoirai à tous tes besoins. » Il les fit entrer dans sa maison, déchargea les ânes, offrit de l’eau pour laver les pieds. Un feu fut allumé, un repas partagé. Une lueur de chaleur humaine dans la nuit froide.
Mais alors qu’ils étaient à réconforter leur cœur, des coups violents ébranlèrent la porte. Des voix rauques, nombreuses, exigeantes, encerclèrent la maison. C’étaient des hommes de la ville, des vauriens, qui cernèrent l’endroit en frappant. « Fais sortir l’homme qui est entré chez toi, crièrent-ils au vieil homme, que nous le connaissions ! » Le verbe « connaître » là, dans la nuit, avait une résonance de viol et de mort.
Le vieil homme, pâle, sortit vers eux. « Non, mes frères, ne faites pas ce mal. Cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille, qui est vierge, et sa concubine. Laissez-moi vous les amener, faites-leur ce qu’il vous plaira. Mais contre cet homme, ne commettez pas cette action insensée. » L’offre était horrible, un calcul de survie déchirant. Le Lévite, lui, prit sa concubine et la poussa dehors, vers eux. La porte se referma.
La nuit absorba la jeune femme. Les hommes la connurent, abusèrent d’elle toute la nuit jusqu’au matin. À l’aube, ils la relâchèrent. Elle tomba à l’entrée de la maison, les mains sur le seuil, dans la lumière grise. Son maître, à l’intérieur, se leva enfin, ouvrit la porte pour partir. Il la trouva là, effondrée. « Lève-toi, allons-nous-en », dit-il. Aucune réponse. Elle était immobile. Il la chargea sur son âne et rentra chez lui.
Arrivé dans sa maison, il prit un couteau, saisit le corps de sa concubine, et la divisa membre par membre en douze morceaux. Il les envoya dans tout le territoire d’Israël par des messagers. Partout où arrivaient ces restes horribles, un silence de stupeur s’abattait, puis un murmure qui montait en clameur : « Jamais chose pareille n’est arrivée, jamais on n’a vu cela, depuis le jour où les Israélites sont montés d’Égypte jusqu’à ce jour. »
L’histoire ne s’arrêtait pas là. Elle déclencha une guerre civile, une vengeance effroyable contre la tribu de Benjamin, presque anéantie. Mais ce qui frappe, dans ce récit, c’est l’enchaînement des petites lâchetés, des silences complices, des hospitalités retardées, des portes qui se ferment. Chaque personnage, sauf la femme sans nom, essaie de négocier avec le mal, de l’orienter ailleurs, de le contenir. En vain. Le mal, une fois invité, consume tout.
Et cette phrase, au début et à la fin, résonne comme un glas : « En ces jours-là, il n’y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Le récit ne juge pas explicitement. Il expose. Il montre la décomposition d’une société où la loi du plus fort, du plus nombreux, du plus cruel, remplace la loi de Dieu. La théologie est dans l’horreur même du constat : sans autorité juste, sans crainte de l’Éternel, l’homme retourne à la sauvagerie. La concubine, muette du début à la fin, en est le sacrifice silencieux. Son corps démembré devient le symbole déchiré d’un peuple qui, en se divisant, s’autodétruit.