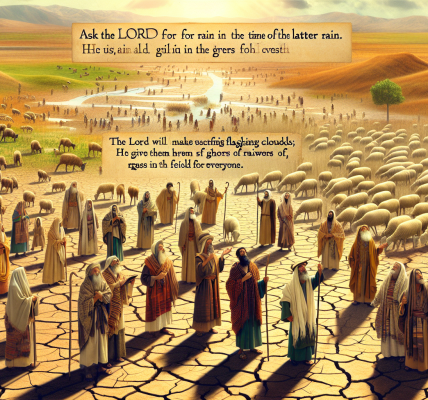L’été brûlant avait calciné les champs d’Anathoth. L’air lui-même semblait lourd de cendre et de silence, un silence si épais qu’il étouffait même le chant des cigales. Je marchais sur le sentier poussiéreux menant aux vignes, mais mon cœur n’était pas à la terre. Les paroles, ces paroles qui ne venaient pas de moi, tournaient en moi comme un vin aigre. Un reste de la moisson pourrissait çà et là, abandonné. Personne n’était venu tout ramasser.
C’est alors que la vision m’a saisi. Non pas une vision de lumière, mais une vision de l’ordinaire perverti. Je voyais les os. Pas ceux des tombeaux, non. Des os qui gisaient au grand soleil, aux portes de la ville, aux carrefours, sous les térébinthes des hauts lieux. Les os de ceux que nous avions aimés, jetés là, oubliés. Et une voix, sans écho, chuchotait dans le vent sec : *Ils aiment à rester ainsi*. Une absurdité. Qui aimerait cela ? Mais la compréhension vint, glaciale. Ce n’était pas les os qu’ils aimaient. C’était l’état où ces os les laissaient. Libres. Sans mémoire. Sans dette.
Je suis rentré, la sueur collée à mon dos. La maison était fraîche et sombre. J’ai pris le rouleau, la main tremblante non de vieillesse, mais d’une colère triste, immense. Et j’ai écrit ce que j’entendais.
*Pourquoi donc ce peuple, Jérusalem, s’obstine-t-il dans l’infidélité ?* La question résonnait dans le vide de la pièce. Ils tenaient à leur honte comme à un bien précieux. Au marché, on entendait les marchands jurer par Baal et par Yahweh dans le même souffle, un mélange pratique. Les scribes recopiaient avec soin la Loi, et les prêtres psalmodiaient les rites, mais leurs yeux brillaient d’une convoitise malsaine pour le prochain sacrifice, plus gras, plus riche. Ils guérissaient à la légère les blessures de ma peuple, en disant : « Paix, paix ! » alors qu’il n’y avait point de paix. Aucune honte. Ils ne savaient même plus rougir.
Un après-midi, je suis monté jusqu’à l’esplanade du Temple. De là, on voyait la ville s’étaler, bruyante et confiante. Des enfants couraient. Le parfum de l’encens montait, épais. Un prêtre, un homme aux joues pleines et aux mains douces, enseignait un petit groupe. Il citait les prophètes d’autrefois, parlait de retour, de pardon assuré. Ses paroles étaient lisses comme l’huile. Je l’ai interpellé, malgré moi, la voix rauque : « As-tu consulté la parole ? Vraiment ? Que dit-elle ? » Il m’a regardé, agacé, puis a détourné les yeux. Ils ne connaissaient pas l’ordonnance du Seigneur. Ils l’avaient remplacée par un assortiment de coutumes commodes. Le scribe, à côté de lui, hochait la tête, plongé dans son étude d’un texte marginal. Ils étaient habiles à se perdre dans les détails pour éviter la Vérité qui les dérangeait.
La sentence, alors, est tombée dans mon esprit, claire et terrible. Elle n’avait pas la douceur des paroles du prêtre. Elle était comme du métal froid. *Je vais les ramasser, dit le Seigneur. Il n’y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier. La feuille même sera flétrie.* Je regardais les figuiers alentours, lourds de fruits presque mûrs. Une image si contraire à ce qui allait venir. Le peuple crierait, bien sûr. « Pourquoi le Seigneur notre Dieu nous fait-il tout cela ? » Ils demanderaient, sincères dans leur incompréhension. Et il faudrait répondre : « C’est parce que vous m’avez abandonné pour servir des dieux étrangers dans votre pays. » La simplicité de la cause était accablante.
Le pire était à venir. La vision a repris, plus précise. Le désastre ne viendrait pas seulement de la terre stérile. Il viendrait du nord. Un bourdonnement, d’abord lointain, qui deviendrait grondement. Des chevaux, plus rapides que les vautours du ciel. Leur hennissement serait la seule fanfare. Et notre terre, si belle, si confiante, serait livrée. Leurs tentes dans nos champs, leur odeur dans nos rues. Un frisson m’a parcouru, malgré la chaleur.
Et alors, une douleur a surgi en moi, si vive qu’elle m’a coupé le souffle. Ce n’était plus ma propre détresse. C’était *Sa* détresse. Une lamentation qui emplissait le ciel et que je devais porter. *Mon chagrin est au-dessus de tout chagrin, mon cœur est malade en moi.* Je l’ai senti, ce mal. Comme une fièvre. Écoutez ! Le cri de la fille de mon peuple retentit sur toute la terre, d’un bout à l’autre. « La paix serait-elle perdue à jamais ? » La question était un gémissement. Et la réponse était le silence. Le silence de Dieu, plus terrible que le tonnerre.
Je suis allé vers les champs, vers les vergers, là où on cherche normalement du baume. Le Galaad, si loin, avec ses résines précieuses. Il y avait du baume, oui. Des pots dans les maisons des riches, des onguents parfumés. Mais il n’y avait point de médecin. La blessure était à l’âme, et personne ne savait, personne ne voulait la panser. Alors à quoi bon le baume ? Elle suppurait, cette blessure. Elle empestait.
Je me suis assis sur une pierre, épuisé. Le soleil commençait à décliner, jetant de longues ombres qui déformaient tout. Le bruit de la ville montait, joyeux, inconscient. Et les mots finals se sont imposés, simples et désespérés. *La moisson est passée, l’été est fini, et nous, nous ne sommes pas sauvés.*
C’était cela. L’été de la grâce était fini. Les derniers grains étaient tombés. La nuit allait venir, longue et froide. Et nous étions là, les mains vides, à regarder les ombres s’allonger, attendant un salut qui, par notre faute, avait déjà quitté la ville.