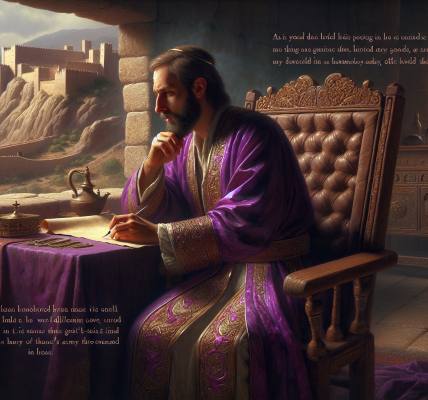La vision me saisit encore, comme un vent qui ne prévient pas. Je me tenais, une fois de plus, devant le seuil de la Maison, et le bruit des chants et des parfums d’encens n’étaient plus qu’un souvenir dans la pierre. C’est alors que je le vis : de sous le seuil même, du côté de l’orient, l’eau jaillissait. Non pas un torrent violent, mais une source obstinée, une veine d’argent liquide qui coulait sans bruit, comme honteuse de sa propre fraîcheur dans ce lieu de solennité.
L’homme qui se tenait à mes côtés – sa présence était devenue aussi familière que l’étrangeté des visions – tenait à la main une corde de lin. Son visage était grave, mais ses yeux brillaient d’une curiosité tranquille. Sans un mot, il passa la porte orientale et je le suivis. L’eau, devant nous, fuyait le parvis, se glissant vers le soleil levant.
Nous marchâmes cinq cents coudées. La mesure était dans ses pas, lents et comptés. Là, il s’arrêta, et je vis qu’il entrait dans l’eau. Elle lui arrivait à peine aux chevilles. Un filet transparent qui serpentait entre les cailloux brûlants du vallon. Il me fit signe de traverser. La fraîcheur fut un choc. Après la poussière et la chaleur de pierre, c’était comme marcher sur un miroir brisé et froid. « As-tu vu, homme ? » murmura-t-il. Je hochai la tête, ne sachant trop quoi voir, sinon cette eau timide.
Nous reprîmes notre marche, encore cinq cents coudées. Le vallon s’inclinait doucement. Il entra de nouveau dans le courant, et cette fois, l’eau lui ceignait les genoux. Son vêtement de lin s’assombrissait, alourdi. Le ruisselet avait gagné en assurance. On entendait maintenant son petit chant, un clapotis contre les roches plus grosses qu’il devait contourner. L’herbe jaunie au bord commençait à verdoyer par plaques, comme si la vie, surprise, se réveillait sur son passage.
Une troisième mesure de cinq cents coudées. L’homme s’enfonça, et l’eau lui monta jusqu’aux reins. Ce n’était plus un ruisseau. C’était un cours d’eau, large déjà de plusieurs pas, qui creusait son lit avec une patience de siècles. Son murmure était devenu une voix, basse et continue. L’air lui-même changeait ; il portait une humidité douce, un avant-goût de fécondité. Je respirai à pleins poumons, et l’odeur de la poussière mouillée me parut plus sainte que tous les encens.
Il poursuivit. Encore cinq cents. Il leva la main pour m’arrêter au bord. Lui, il entra. Et je le vis disparaître. L’eau lui montait aux épaules, puis couvrit sa tête aux cheveux gris. Un instant de silence, mon cœur se serra. Puis il émergea plus loin, soufflant comme un nageur heureux. Il se retourna, et son rire clair surprit le vallon. « Viens-tu ? » lança-t-il. Mais je restai sur la rive, saisi par la vue. L’eau était devenue un fleuve. Un vrai fleuve, impossible à traverser à gué. Un fleuve qui roulait une eau claire, profonde, vivante, vers la plaine aride qui s’étendait à l’orient, vers ce pays de soif qu’on nomme la Arava.
Alors il revint vers moi, ruisselant, et son doigt traça une ligne vers l’aval. « Suis son cours, homme. Regarde ce qu’elle fait. »
Je marchai le long de la rive, et la vision se déploya, non plus en mesures, mais en tableaux de grâce. Le fleuve coulait vers la mer orientale, cette mer de Sel, cette eau morte et épaisse où rien ne vivait. Et à mesure qu’il avançait, la terre se métamorphosait. Sur les deux rives, des arbres surgissaient. Pas n’importe quels arbres. Des arbres fruitiers de toute espèce, dont les feuilles ne se flétrissaient pas et dont les fruits ne tarissaient pas. Ils portaient du fruit chaque mois, parce que l’eau qui les nourrissait sortait du sanctuaire. Leurs fruits seraient pour la nourriture, et leurs feuilles pour la guérison.
Je m’arrêtai, le souffle coupé. Un figuier voisinait avec un grenadier, un vignoble s’enlaçait à un tronc de cèdre. La sève du sanctuaire abolissait les saisons et confondait les espèces dans une profusion paisible. L’air était lourd du parfum des citrons et du miel des dattes mûres. Et partout, le bruissement des feuilles, un chuchotement perpétuel, comme une litanie de gratitude.
Le fleuve, lui, pressait son cours. Je le vis se jeter enfin dans la mer Morte. Et là se produisit le miracle des miracles. Les eaux salées, lourdes de mort, furent assainies. L’endroit où se mêlaient les deux courants devint une eau douce, vivante. Une vie si explosive qu’elle devint grouillante. Partout où parviendrait le fleuve, me dit la voix à mon côté, tout vivrait. Des bancs de poissons innombrables, de toutes espèces, comme dans la grande mer de l’occident. Des pêcheurs viendraient, d’En-Guédi à En-Églaïm, ils étendraient leurs filets sur cette mer autrefois morte. Ses marais et ses lagunes ne seraient pas assainis ; on y laisserait le sel, pour le souvenir et pour l’alliance. Mais le lit du fleuve, et ses rives, seraient un jardin.
Je tombai à genoux dans l’herbe humide. Ce n’était pas une allégorie. C’était plus vrai que la pierre sous mes genoux. C’était la carte d’un monde nouveau, tracée à l’encre d’eau vive. La source du temple, cachée, minuscule, devenant un fleuve impossible à franchir, transformant le désert en verger et la mort en vie foisonnante. La Loi sortant de Sion, la parole de l’Éternel de Jérusalem, non comme un décret de pierre, mais comme un flux patient, profond, qui imprègne tout, soigne tout, féconde tout sur son passage.
La vision s’estompa lentement. La fraîcheur resta sur ma peau. L’odeur des fruits mûrs flotta encore un instant dans l’air sec. Je me relevai, les membres engourdis. Je regardai mes mains. Je m’attendais presque à y voir perler l’eau du sanctuaire. Il n’y avait que la poussière du voyage. Mais une certitude, désormais, coulait en moi, sourde et puissante comme un fleuve souterrain. Un jour, le seuil laisserait tout partir. Et le désert chanterait.