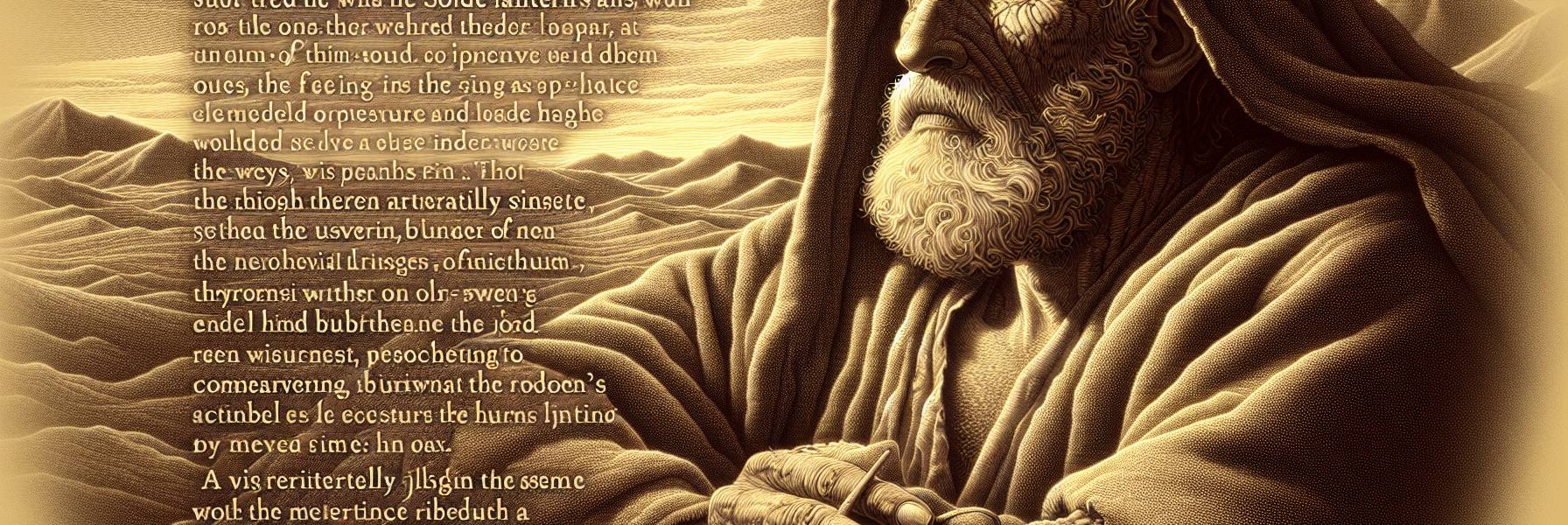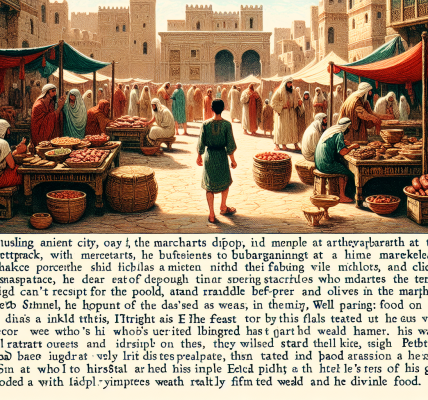Je me souviens.
Il y a des jours où le souvenir est plus présent que l’ombre portée sur le mur. Il pèse, il écrase, il enveloppe. Aujourd’hui, c’est un de ces jours. Le soleil est haut, impitoyable, mais sa chaleur ne me parvient plus. Elle reste à la surface de ma peau, comme tout le reste. Je suis assis sur ce tas de cendre, et je me souviens.
Tout a commencé par la lumière. Non pas celle du ciel, mais une autre, intérieure, qui semblait couler de la présence même du Très-Haut. Dieu veillait sur ma tente. Je pouvais le sentir, ce n’est pas une façon de parler. Une sérénité profonde, comme la lueur d’une lampe à huile pure qui ne faiblit jamais. Mes enfants grandissaient dans cette clarté. Les rires autour du foyer, les disputes des jeunes hommes, les chuchotements des filles, tout était baigné dans cette bénédiction tangible. C’était la saison où le sentier de ma vie était trempé de crème, et le rocher à côté de moi faisait couler des ruisseaux d’huile.
Je sortais alors, vers la place de la ville, près de la porte où les anciens se tenaient. Mes pas n’étaient pas ceux d’un homme pressé, mais d’un homme attendu. Je les revois, assis sur les bancs de pierre usés par les générations, se taire à mon approche. Pas par crainte, mais par… attente. Les cheveux blancs de Barakel, les mains noueuses de Shiméon posées sur sa canne, tous se taisaient. Les princes arrêtaient de parler, ils mettaient la main sur leur bouche. La voix des nobles se perdait, leur langue collait à leur palais. Un silence de respect, lourd comme un manteau d’honneur qu’on dépose sur vos épaules.
Et puis, ils parlaient. Et j’écoutais. Une veuve, la voix cassée par les larmes et la fumée du foyer éteint. Un orphelin, les yeux trop grands dans un visage maigre, qui n’avait jamais connu le soutien d’une main paternelle. L’homme qui se mourait, littéralement, l’homme perdu, le dos courbé sous un destin qu’il ne comprenait plus. Ils venaient. Ils se tenaient là, dans l’ombre du portail, et ils cherchaient mon regard.
Je n’avais pas de formule magique. Je n’avais pas de potion. J’avais… du temps. Et la conviction, chevillée au corps, que la justice n’était pas une idée mais un acte. Je rompais la mâchoire du méchant, c’est une image violente, je le sais. Mais c’était cela : arracher de sa gueule la proie qu’il s’apprêtait à dévorer. Une terre injustement saisie, un salaire retenu, un héritage confisqué par un parent avide. Je faisais cela. Et soudain, l’homme qui se croyait perdu retrouvait une semence d’avenir. Ses yeux se mettaient à briller d’une lueur que je n’oublierai jamais. C’était une étincelle d’humanité rendue. Je faisais de l’homme perdu un homme de nouveau.
Et alors… alors j’étais comme… comment dire ? Comme un père. Pour les pauvres, pour l’étranger que personne ne connaît, qui erre avec ses dieux étranges et son accent rugueux. Je cherchais sa cause, une cause que personne ne cherchait. Parce qu’il avait un visage, et que ce visage portait l’image de Celui qui m’avait comblé. Je poursuivais l’homme violent, l’homme au poing facile, au cœur dur comme la pierre de meule, et je l’abattais. Pas physiquement, mais par la seule force du droit, du témoignage, de l’évidence rétablie. Et il ne se relevait pas de son injustice.
Tout cela, je le faisais. Et ma vie en était tissée. Ma justice me vêtait comme un manteau, mon équité était un turban et un diadème. J’étais des yeux pour l’aveugle, des pieds pour le boiteux. La pluie, en automne, sur une terre fissurée. J’étais cela. Je siégeais à la tête des hommes, j’habitais comme un roi dans son armée, comme quelqu’un qui console les affligés. Parce que la consolation, vois-tu, ce n’est pas seulement une parole douce. C’est un toit, un droit rétabli, une bouchée de pain et la certitude que demain, le soleil se lèvera sur un horizon moins noir.
Ils m’écoutaient, ensuite. Ils attendaient mon conseil comme on attend la pluie de printemps après un hiver sec. Ils se taisaient pour recueillir ma parole. Après que j’avais parlé, ils ne répliquaient rien. Ma parole tombait sur eux comme une goutte de rosée fine, et ils la laissaient couler, lentement, pour qu’elle imprègne le sol de leur pensée. Ils me bénissaient. Un sourire, un hochement de tête, un « Que Dieu te garde, Job » murmuré avec une reconnaissance qui n’avait rien de servile.
Je choisissais leur voie, je siégeais comme leur chef. Je demeurais comme un roi au milieu de ses troupes, comme quelqu’un qui console les endeuillés. Comme quelqu’un…
Le souvenir se brise. La lumière a changé. Elle est maintenant crue, verticale, elle ne baigne plus, elle frappe. La chaleur, enfin, me traverse. Elle ne vient plus de la présence, mais de ce soleil de plomb sur un amas de ruines. Mes mains, posées sur mes genoux, ne sont plus celles qui brisaient les injustices. Elles sont couvertes de plaies. Le manteau d’honneur a été remplacé par cette rudesse de sac qui gratte ma peau à vif. Le silence qui m’entoure n’est plus un silence de respect. C’est un silence de désolation. Les jeunes garçons qui me voient se cachent. Les pères me retiennent par le bord de mon vêtement déchiré.
Je me souviens. Et dans la bouche, le goût du souvenir est plus amer que la cendre sur laquelle je suis assis. C’était avant. Quand mes pas étaient baignés de crème, et que le rocher faisait couler pour moi des ruisseaux d’huile.