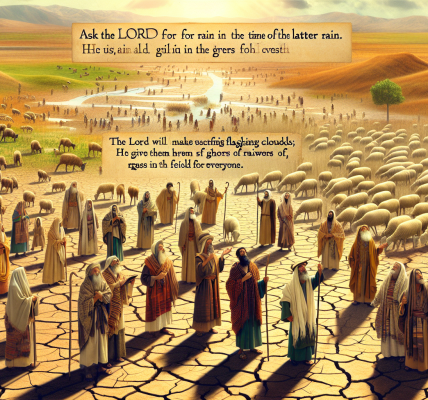Le soleil d’Égypte cognait sur les murs de plâtre blanc de la maison de Potiphar. C’était une chaleur épaisse, palpable, qui faisait trembler l’air au-dessus des cours et alourdissait les parfums des jardins. Joseph, le jeune Hébreu, sentait la sueur couler dans son dos sous sa tunique de lin fin. Il n’était plus tout à fait l’adolescent vendu par ses frères. Les années sous ce ciel implacable avaient affermi ses traits, élargi ses épaules, mais c’était dans le regard qu’on percevait le changement : une gravité tranquille, une manière d’observer le monde comme s’il y lisait un autre texte, invisible aux autres.
Potiphar, officier de Pharaon et chef des gardes, n’avait pas tardé à le remarquer. Ce n’était pas seulement l’efficacité du jeune homme, sa façon de régler les comptes des métayers ou d’organiser les réserves sans qu’un grain de blé ne manque. C’était une présence. La maison semblait prospérer sous sa main, comme une plante qu’on arrose à point nommé. Potiphar, homme pratique et superstitieux comme tout Égyptien de sa caste, y vit la faveur des dieux – ou d’un dieu. Il finit par tout lui confier. Les clefs des greniers, le sceau domestique, la gestion des serviteurs. Joseph devint l’ombre maîtresse de la demeure. Il dormait dans une petite pièce attenante aux archives, et la nuit, à la lueur d’une lampe à huile, il pensait parfois aux collines de Canaan, au visage vieillissant de son père. Ces souvenirs lui serraient la gorge, mais il les gardait comme des pierres précieuses qu’on ne sort qu’en secret.
Et il y avait elle. L’épouse de Potiphar. Une femme du pays, élevée dans le luxe oisif des maisons militaires. Elle avait la beauté des statues : des yeux immenses soulignés de khôl, des bras fins ornés de bracelets d’or qui chantaient un petit air froid à chacun de ses gestes. L’ennui était son principal compagnon. Les jours se ressemblaient, rythmés par les allers-retours de son mari, les commérages des servantes, les bains parfumés. Puis vint Joseph. Elle le vit d’abord comme un élément du décor, un serviteur de plus, plus silencieux que les autres. Mais peu à peu, sa présence devint une ponctuation dans sa monotone journée. Elle l’observait, de l’ombre des portiques, discuter avec l’intendant des vignes, redresser le dos pour essuyer son front, sourire à un enfant qui courait dans la cour. Il y avait en lui une dignité qui résistait à sa condition. Cela l’intrigua. Puis l’irrita. Enfin, l’enflamma.
Un matin où la chaleur était déjà lourde, elle le fit appeler sous le prétexte d’un compte à vérifier. La pièce était fraîche, les stores de roseaux baissés découpant la lumière en lamelles dorées. Elle était là, à demi allongée sur un lit de repos, une coupe de vin à la main.
« Joseph, approche. Raconte-moi. D’où viens-tu vraiment ? Ton dieu, quel est son nom ? »
Sa voix était douce, traînante. Il répondit par des généralités, poli mais distant. Elle sourit, reposa sa coupe. Ce fut le début.
Les occasions se multiplièrent. Une question sur un tissu, un ordre à propos du jardin, un message à transmettre. Elle se plaçait sur son passage, dans l’escalier étroit menant aux terrasses, dans la pénombre du couloir des réserves. Son regard, d’abord interrogateur, devint insistant, puis brûlant. Joseph sentait le danger. Il l’évitait. Il raccourcissait les conversations. Il gardait en tête, comme un bouclier, les paroles et les silences de son enfance : l’alliance, la promesse, la présence du Dieu de son père, même ici, sous ce ciel étranger. Ce n’était pas une règle abstraite, mais une réalité qui tenait ses os debout.
Puis vint le jour où Potiphar partit en inspection pour plusieurs jours. La maison sembla retenir son souffle. Joseph redoubla de vigilance, s’enfermant dans les comptes, inspectant les domaines à l’extérieur. Mais le destin, ou le piège, est patient.
C’était en fin d’après-midi. La plupart des serviteurs vaquaient aux dernières tâches. La maison bourdonnait de cette paix lasse qui précède le soir. Joseph devait rapporter des rouleaux dans la bibliothèque de son maître, une pièce intime qui donnait sur les appartements privés. Il traversa la cour, les papyrus sous le bras. La pièce était vide, fraîche. Alors qu’il rangeait les documents dans un coffre de cèdre, il perçut un frôlement derrière lui. Elle était là, sur le seuil. Elle avait renvoyé ses suivantes. Elle portait une robe de lin si fin qu’il devinait la forme de ses hanches dans la lumière tamisée.
« Joseph. »
Il se raidit, sans se retourner.
« Maîtresse. Les documents sont rangés. Si tu permets, je dois… »
« Reste. »
Le ton n’était plus celui d’un ordre, mais d’une supplication ardente. Elle s’approcha. Il sentit le parfum de myrrhe et de lotus, lourd, enivrant.
« Regarde-moi. Personne n’est là. Mon mari est loin. Nous sommes seuls. Depuis trop longtemps, tu me fuis. »
Il se tourna enfin, mais son regard passa à travers elle, se fixant sur un motif du mur.
« Maîtresse, mon maître m’a tout confié dans cette maison. Il ne m’a rien interdit, sauf toi. Tu es son épouse. Comment pourrais-je commettre un tel mal, et pécher contre Dieu ? »
Sa voix était basse, ferme, sans colère. La question résonna dans le silence. La femme de Potiphar eut un rire bref, nerveux.
« Ton Dieu ? Quel dieu voit dans l’obscurité d’une maison égyptienne ? Ici, nous avons d’autres dieux. Des dieux de la vie, du désir. »
Elle avança encore, posa une main sur son bras. Le contact était brûlant.
« Je t’en prie, Joseph. »
Alors, il recula. Brusquement. Le geste fut si vif qu’il la déstabilisa. Une rage soudaine, humiliée, embrasa son visage. Elle agrippa sa tunique – cette tunique fine, signe de son statut privilégié.
« Viens ! »
Il se dégagea d’une secousse, mais le tissu craqua. La tunique lui resta dans la main, tandis qu’il se précipitait hors de la pièce, dénudé jusqu’à la ceinture. Il courut. Les couloirs lui parurent interminables. Derrière lui, il entendit un cri, puis des sanglots hystériques.
Il se réfugia dans ses quartiers, le cœur battant à grands coups sourds. Il savait. Le jeu était joué. Il attendit, assis sur le bord de son lit de jonc, dans la pénombre.
Les heures passèrent. Le soir tomba. Puis ce furent des bruits de pas lourds dans la cour, des lampes qui s’allumaient, des chuchotements excités. On vint le chercher. Dans la grande salle de réception, des torches fumaient. Potiphar était là, de retour plus tôt que prévu, le visage fermé comme une pierre. À ses pieds, son épouse était éplorée, la tunique de Joseph serrée contre elle comme un trophée macabre.
« L’esclave hébreu que tu nous as amené ! Il est entré chez moi pour se jouer de moi ! J’ai crié, et il a pris la fuite en laissant sa tunique ! »
Elle jetait les mots comme des couteaux, entre deux sanglots convaincants. Potiphar regardait la tunique, puis Joseph, debout, silencieux, les bras croisés sur sa poitrine nue. Il connaissait sa femme. Il connaissait Joseph. Il voyait la fureur dans les yeux de l’une, et la paix terrible dans le regard de l’autre. Mais l’honneur d’un officier de Pharaon, le qu’en-dira-t-on, la loi du plus fort… Tout cela pesa plus lourd que la vérité qu’il devinait.
Son visage se vida de toute expression. Il ordonna d’un geste bref.
« Qu’on l’emmène. À la prison du roi. Là où sont enfermés les prisonniers du roi. »
Joseph ne dit rien. On lui lia les mains. Il jeta un dernier regard à cette maison qui avait été presque la sienne. Il n’y vit ni triomphe ni désespoir. Alors qu’on le poussait vers la nuit fraîche, il leva les yeux vers le ciel criblé d’étoiles, les mêmes qui veillaient sur les tentes de son père. Et il marcha, nu-torse, vers le cachot, portant en lui un étrange sentiment, non pas d’injustice subie, mais d’une présence qui, même dans les ténèbres du puits ou des geôles égyptiennes, ne lâchait pas sa main.